
Fig. A. À poêle.
[dèrjèr le pwal] (gr. n. TYPO.)
Une pudeur extrême anime la langue surannée qui ne se plaît guère à frustrer ceux auxquels elle s’adresse. Elle ne sait pas dire non, elle est comme ça, cherchant toujours à faire plaisir.

Fig. A. À poêle.
Une pudeur extrême anime la langue surannée qui ne se plaît guère à frustrer ceux auxquels elle s’adresse. Elle ne sait pas dire non, elle est comme ça, cherchant toujours à faire plaisir.

Fig. A. Cocoooooo, cooooco.
Rassurons les amis des animaux : aucun cacatoés rosabin, aucun ara, aucun jaco, ni même aucun bavard impénitent n’a été blessé pour la mise au point de cette définition. Le langage suranné quand il fait dans l’image violente, ne joint jamais le geste à la parole.

Fig. A. Napoléon Bonaparte et son fameux geste des bonbons qui collent au papier. Musée d’Ajaccio.
Si les premiers bonbons datent du XIIᵉ siècle et du retour des Croisés avec la canne à sucre à défaut de Graal, il faudra attendre le XIXᵉ siècle et la mise au point de l’extraction industrielle du sucre de betterave en 1811 par Benjamin Delessert et Jean-Baptiste Quéruel pour lancer véritablement l’histoire de la friandise sucrée.
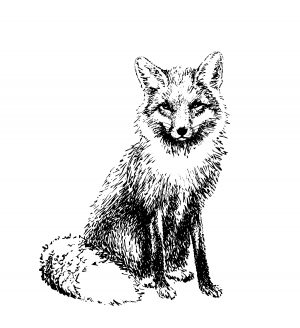
Fig. A. Un renard parmi cent mille renards.
La langue surannée est parfois sombre et cruelle. Somme toute bien consciente de son côté obscur, c’est aussi pour cela qu’elle se terre au fond des livres anciens et se tient à distance du phrasé des modernes. Cette définition est donc à la fois sale et méchante, vous voici prévenus.

Fig. A. Un gamin à rhabiller. Archives du Balto.
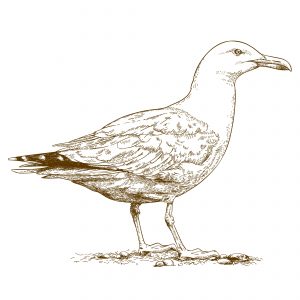
Fig. A. Mouette à l’œil rieur.
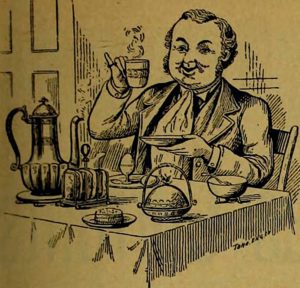
Fig. A. Homme aimant se beurrer la biscotte.
La langue surannée ne fait jamais dans l’à-peu-près. Elle est précise, chirurgicale, et la moindre de ses nuances fait bifurquer un sens. Ciselée comme une œuvre, elle fait d’une différence subtile un monde à explorer et c’est dans celui doux ou salé du beurre que nous allons nous plonger.

Fig. A. Socrate prenant le bouillon de onze heures.
Incomplète, mâtinée, une expression surannée devient moderne et perd de sa force évocatrice. Refusant le pis aller d’une langue fatiguée, voici que nous nous retrouvons à défendre les empoisonneurs qui firent les beaux jours de la faucheuse au XVIIᵉ.
On aura tout vu en ces lignes…

Fig. A. Prix pas cher faisant des queues aux zéros. Musée de la grande distribution.
L‘inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l’augmentation du coût de la vie.
Enfin ça c’est l’INSEE qui essaye de nous le dire simplement, mais nous on sait bien que le seul truc qui compte c’est que les prix aient augmenté, pas que ce soit la faute à pas de chance ou au sens de l’histoire.

Fig. A. 16-18 août 1870. Bataille de Gravelotte.
Avec ses 836 habitants recensés en 2014 par les services de l’Etat dûment mandatés pour ce faire, la petite commune mosellane de Gravelotte possède toutes les apparences du village français anonyme et tranquille entendant bien rester et l’un et l’autre.